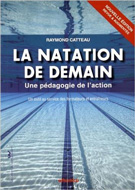Vous êtes ici : Accueil > Espace pro > Histoire de la natation scolaire - partie 3
Histoire de la natation à l'école - Raymond Catteau, une natation unitaire
Dans les années 60 et 70, de vastes plans de créations d'équipements vont enfin permettre une véritable généralisation de l'enseignement de la natation à l'école. Parallèlement, les objectifs des activités physiques à l'école changent et les fonctions utilitaires telles que la santé et l'hygiène ne sont plus les seules à rentrer en ligne de compte. Les sports institutionnels, codifiés, font leur entrée dans l'enseignement, et l'on considère de plus en plus que savoir les pratiquer doit faire partie de la culture de l'élève au même titre que les autres matières.
La vision de la natation évolue vers une conception unitaire : il n'existe plus de séparation entre la natation compétitive et celle pratiquée à l'école. Il y a une seule natation, avec une continuité de l'élève débutant jusqu'au champion.
Sous l'influence de différents auteurs et en particulier de Raymond Catteau, différents modèles de progression et une nouvelle pédagogie vont être proposés pour l'enseignement de la natation.
Le modèle ERP
A l'origine de la construction de ce modèle il y a une recherche des composantes fondamentales communes aux différentes nages. L'activité natation est ainsi structurée autour de trois pôles : l'équilibre, la respiration et la propulsion. Ce modèle évoluera au cours des années 60 et 70 avec, en particulier, l'ajout d'un 4ème pôle constitué par la prise d'informations.
C'est un changement profond car les objectifs de la natation scolaire ne sont alors plus seulement définis en terme de maîtrise de techniques de nage. Devenir nageur va supposer des transformations dans chacun de ces pôles et ainsi :
- Passer d'un équilibre vertical à un équilibre horizontal.
- Passer de l'apnée à une respiration rythmée, et coordonnée aux mouvements<./li>
- Passer d'une organisation terrienne, où les bras ont plutôt une fonction équilibratrice et les jambes propulsive, à une organisation aquatique ces fonctions sont inversées.
- Accepter d'abandonner en partie les informations visuelles et les remplacer par des sensations (informations proprioceptives).
Des comportements typiques pour chaque niveau de pratique peuvent alors être définis.
| Niveau | Equilibre | Respiration | Propulsion | Informations |
|---|---|---|---|---|
| Non nageur | Oscille entre la verticale et l'obliquité | Respiration aérienne | Essentiellement par les jambes, en pédalage, les bras sont sustentateurs. | Visuelles, orientées sur l'objectif à atteindre, toujours au-dessus de l'eau |
| Niveau intermédiaire | Corps globalement horizontal (sauf au moment des prises inspiratoires) et oscillations fréquentes dans les différents plans | Alterne phases d'expiration sous marines et inspiration- respiration aérienne (expirations partiellement aériennes) | Trajets moteurs allongés mais souvent désaxés, incomplets. | Idem mais prend quelquefois des repères sur les bords du bassin (voir au fond), commence à utiliser les sensations de glisse |
| Nageur | Les déséquilibres maîtrisés favorisent les actions propulsives. | Respiration aquatique et évolutive suivant l'épreuve ou les temps de nage au fil de l'épreuve | Les appuis sont profonds, rythmés et coordonnés bras/jambes | Prend des informations externes latéralement (prises inspiratoires), aquatiques (fond du bassin) et gère ses capacités à l'effort (sensations) |
Le modèle du corps flottant – corps projectile – corps propulseur
Il est proposé par Raymond Catteau à partir de 1992 et détaillé dans son ouvrage intitulé la natation de demain. Suivant les mêmes objectifs que le modèle ERP, il propose une progression en trois grandes étapes.

Exemple d'exercice proposé à des débutants au grand bassin
La première étape est celle du corps flottant. L'élève construit progressivement un équilibre spécifique au milieu aquatique qui est fondamentalement différent de l'équilibre terrestre en raison de l'existence de la poussée d'Archimède. Pour cela, Raymond Catteau préconise d'abandonner le matériel de flottaison et de réaliser les premiers apprentissages au grand bassin. Ceci se fait au départ grâce à des appuis solides (goulotte, rebord, perches) mais en se passant le plus possible des appuis des pieds au sol. On peut considérer que le corps flottant est acquis lorsque l'élève peut se laisser flotter, et modifier la forme de son corps pour changer sa position dans l'eau.
L'étape suivante est de construire le corps projectile, c'est-à-dire la capacité à se positionner pour passer à travers l'eau avec un minimum de freinage. Le plongeon, réalisé dans une position profilée, est la forme la plus aboutie du corps projectile.
Enfin, l'étape du corps propulseur consiste à se déplacer de plus en plus efficacement grâce à l'action des bras et des jambes, puis à synchroniser sa respiration pour pouvoir prolonger ce déplacement. Le crawl et le dos sont abordés en premier car ils permettent d'assurer plus facilement le maintien du corps projectile. La brasse, qui était traditionnellement la première nage enseignée, est abordée en fin d'initiation car elle s'écarte de la logique commune aux autres nages où les bras assurent l'essentiel de la propulsion.
Ce modèle présente une continuité totale entre les premiers apprentissages et la natation orientée vers la performance. Les acquisitions réalisées à chaque étape sont réinvesties lors de l'étape suivante. Il est toujours très enseigné dans les formations de maître nageur.
Une pédagogie active
Les modèles proposés à partir des années 60 s'accompagnent d'une nouvelle démarche pédagogique. Comme il ne s'agit plus d'apprendre et de répéter les "bons mouvements", l'enseignement magistral peut être abandonné au profit de pédagogies plus actives.
C'est par les exercices proposés et par la définition des critères de réussites que le maître va inciter l'élève à se transformer. A lui de trouver les moyens de résoudre la tâche proposée (comment réaliser la coulée la plus longue possible par exemple), d'expérimenter différentes solutions possibles et de sélectionner celle qui est la plus efficace.
L'enseignement de la natation suit ainsi l'évolution de la pédagogie à l'école où l'on considère de plus en plus la participation de l'élève et l'expérimentation comme des conditions de la réussite.